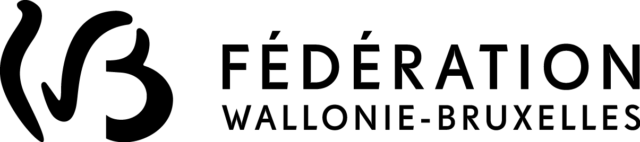30.04 → 24.07.1999
Intra-murosPrix de la Gravure – Dix ans
Les 10 lauréats depuis 1989 sont à l’honneur au Centre de la Gravure :
1989 Kikie Crèvecoeur
1990 Thierry Lenoir
1991 Sylvie Canonne
1992 Jean-Pierre Scouflaire
1993 Lukasz Kurzatkowski
1994 Chris Delville
1996 Anne Leloup
1997 Claude Celli
1998 Lionel Lesire
1999 Philippe De Kemmeter
« Encre et papier ». Telle se présente, en résumé, la gravure : fleurs de noirs, éparpillements de couleurs sur fibres et chiffons broyés et confondus. Mais, la gravure, c’est aussi travaux de presse, gestes techniques contrôlés et minutieux, jeux d’outils (lames, couteaux, gouges), alchimies d’acides, vernis, laques… Par surcroît d’émotion, par finesse de vision, par besoin d’art. La gravure, aujourd’hui, est en effet surtout un art auquel il n’est nullement prétentieux d’accoler le qualificatif d’« innovant », tant cette expression plastique, éloignée pour toujours des principes de reproduction et de multiplication qui la justifiaient entièrement en ses débuts, favorise une création vaste en son propos, diversifiée en ses méthodes, résolue en sa signification et sa maturation. Tel est d’ailleurs le portrait qu’avec une subtile pertinence, les Jurys du Prix de la Gravure ont donné de cet art de l’estampe à travers les œuvres primées, multiformes et broussailleuses, de neuf créateurs issus d’espaces étonnamment variés de la Communauté française de Belgique.
Tenter de faire le bilan de dix années de Prix, c’est donc se heurter à un monde grouillant de formes et de techniques, d’inspirations et de jubilations. Inutile de chercher à voir des courants généraux, des lignes de conduite privilégiées, des ordres de marches imposés : dans la gravure, comme dans le reste de la création plastique – on aimerait dire de la création tout court –, les chemins se multiplient à l’envi, les recherches explorent l’ensemble des possibles, les styles se chevauchent et se pénètrent en cascade. Ainsi est la richesse de notre époque – et donc de notre gravure – qui refuse un sens prédestiné à son histoire, une doctrine privilégiée à ses agissements, une finalité déterminée à ses avances. Ainsi disparaît, en gravure comme ailleurs, dans notre prolifique magma post-moderne, la vieille et fallacieuse notion de progrès. Lionel Lesire a bien raison d’écrire : « c’est cette matière-là qui m’intéresse. Une matière inachevée, dépassée. Mon intérêt est de relier cette matière à des images ataviques, éternelles, pour éprouver que le progrès ne peut exister en art. »
L’art, c’est, pour une part, une technique : une myriade de petits gestes fondamentaux, d’inventives et précises recettes qui, enchaînés point à point, assurent à l’œuvre épiphanie et matière. La gravure vit ainsi autant de ses techniques que de ses états d’âmes. Les différents Jurys du Prix de la gravure l’ont bien compris qui, au fil des années, ont accordé leur intérêt aux procédés les plus divers, aux manières les moins concertées. Couronnant tout autant lithographies que pointes sèches, eaux-fortes que bois, aquatintes que linogravures, les membres – chaque fois différents – des neuf Jurys ont voulu ainsi souligner combien l’univers technique de la gravure est vaste et intrigant. Bien plus, en accordant sa faveur, dès la fondation du Prix, en 1989, à une candidate, Kikie Crèvecoeur, qui utilise des gommes gravées pour estamper ses images, le Jury d’alors a voulu sans aucun doute revendiquer l’importance de cette quête perpétuelle de manières et de procédés nouveaux.
Très actuel en ses choix et principes, Jean-Pierre Scouflaire (lauréat du Prix en 1992) multiplie les recours aux différentes techniques (et donc aux différents formats et aux différents papiers). De surfaces d’aquatinte (dans un petit volume paru aux Editions Tandem par exemple), il passe avec une parfaite maîtrise à l’usage de la linogravure pour affiner ou infléchir une ligne (ainsi dans un petit portefeuille publié par les Editions Altamira) ou encore à l’emploi de la xylographie pour étaler de vastes plans sur papier Japon (comme dans son travail intitulé Living Space). Dans un portefeuille à nouveau publié par Tandem, il presse des bois sur un papier « Canne à sucre » dont les fibres, par leur caractère très matiériste et très présent, ravivent, par contraste, la justesse et la rigueur des lignes et des aplats.
Lauréate du Prix en 1991, Sylvie Canonne n’oublie ni la lithographie ni la linogravure. La pierre, elle l’utilise par exemple pour la publication d’un fort beau petit livre, Le Bassin, publié en 1990. Du lino, elle tire profit pour l’édition de Huit petits paysages (Altamira). Mais, dans les grandes planches – qui ont donné tout son caractère à son travail –, c’est d’eau-forte, d’aquatinte et de pointe sèche qu’il s’agit : tout y est griffures, éraflures, striures en un savant mélange dit « technique mixte ». Dans le même ordre d’idées, si Chris Delville utilise la linogravure pour ses estampes de grand format, elle demeure néanmoins très sensible aux effets veloutés de la pointe sèche dans de petites estampes qui, alliées au texte et à l’expression verbale, paraissent des équivalents revisités, et donc très post-modernes, de certains effets cultivés dans les anciens manuscrits.
Lionel Lesire a obtenu le Prix de la Gravure en 1998. Son œuvre exalte ce que l’artiste a aussi convenu d’appeler les « techniques mixtes ». Mais, dans cet ensemble complexe de procédés et de manières où voisinent notamment eau-forte, vernis mou (qu’il traite à l’aérographe) et, dans certains cas isolés bien sûr, lino (qu’il imprime d’une manière toute particulière), c’est surtout la pointe sèche qui retient son attention. Planche après planche, Lesire poursuit avec une infinie minutie un travail d’innovation et de recherche où « l’amour des gris » (ainsi qu’il se plaît à l’affirmer lui-même) le guide au sein d’un univers très personnel de savants mélanges et de dosages délicats. Chez Lesire, le geste est indissociable de la forme. Et c’est de cette union profonde de l’intention et du traitement matériel que naissent ce raffinement et cette subtilité si caractéristiques de l’œuvre. On est là aux sources mêmes de la gravure.
C’est la linogravure qui fascine Lukasz Kurzatkowski, détenteur du Prix en 1993. En maître des contrastes puissants entre le noir et le blanc, l’artiste se souvient que son dessin original, massif et charpenté, fut lavé au pinceau. Tantôt, sa taille est franche et nette ; tantôt plus libre, plus flottante, plus « déchirée », elle se souvient des repentirs et des hésitations originelles. Primé en 1990, Thierry Lenoir partage avec L. Kurzatkowski l’amour pour la pureté du contraste noir-blanc. Tantôt taillées avec la rare vigueur et la fausse naïveté d’un graveur qui se remémore, sans les copier, les imagiers de jadis, tantôt dégagées de la lourde masse des noirs pour devenir jeux de lignes et de stries, les gravures de Lenoir font aussi appel au lino et au bois. Pour les grandes planches, Thierry Lenoir utilise de préférence la linogravure ; pour les estampes de formats plus réduits, l’artiste choisit plutôt la xylogravure.
La lithographie, quant à elle, a été préférée par deux artistes lauréats du Prix : Anne Leloup (Prix en 1996) et Claude Celli (Prix en 1997). L’une comme l’autre utilisent à merveille les ressources quasi magiques de ce procédé né voici juste deux siècles et auquel, avec tant d’à-propos, le Centre de la gravure et de l’Image imprimée a rendu hommage tout récemment. Crayonnages, lavis, frottis comptent ainsi parmi les nombreuses techniques familières de la lithographie habilement mises en valeur par A. Leloup et C.Celli.
L’image imprimée n’est pas nécessairement artisanale. Les procédés dits « photomécaniques » invitent également les artistes d’aujourd’hui à créer, au départ de ces formules industrielles, des œuvres aussi précieuses, aussi précises que si elles avaient été dictées par la main seulement. En maintes circonstances, les lauréats du Prix de la gravure ne se sont pas privés de solliciter ces techniques actuelles tant, par exemple, pour la réalisation d’affiches (ainsi Kikie Crèvecoeur) que pour illustrer livres ou plaquettes (ainsi Anne Leloup).
Aux infinies variations de la technique correspond, dans le monde de l’estampe actuelle, l’extrême abondance des propos stylistiques. Certes, cette profonde variété des courants et des expressions n’est pas propre à la gravure. L’art actuel, dans sa post-modernité triomphante, nous a habitués à ces multiples voies, ces recherches parallèles, ces discours antagonistes. Qu’aujourd’hui l’abstraction la plus minimaliste fréquente l’expressionnisme le plus démesuré ou la figuration la plus acérée ne chagrine plus personne. Notre époque est ainsi constituée qu’elle accueille tous les styles, toutes les tendances, toutes les recherches. Et l’on ne s’étonne plus qu’un peintre comme Gerhard Richter, auteur de peintures abstraites tantôt rigoureusement géométriques, tantôt emphatiquement lyriques, puis de tableaux figuratifs réinterprétant la photographie, puis de monochromes secs et drastiques écrive à propos de son art : « Je fuis toute fixation. Je ne sais pas ce que je veux. Je suis inconséquent, indifférent, passif ; j’aime l’indéfinissable et l’illimité, et l’incertitude continuelle ! »
Cette diversité qui, chez certains, peut quelque peu faire tourner la tête – ou (et c’est bien là le malheur) suscite, chez d’autres, propos négatifs et théories vengeresses – est heureusement assumée par la majorité des vrais artistes d’aujourd’hui. Cette extrême dispersion, bénéfique, des usages formels et des itinéraires stylistiques a été par ailleurs intelligemment mise en lumière par les choix des neuf différents Jurys du Prix de la gravure. Certaines années, furent couronnées des œuvres abstraites, ou expressionnistes, ou figuratives ; à d’autres moments, furent proclamées des créations où se mêlent et se confondent ces diverses catégories dont on se rend compte, aujourd’hui, qu’elles n’ont jamais été aussi signifiantes que lorsqu’elles se livrent aux jeux des combinaisons, aux partages des limites ou aux effets des échanges.
Malgré un court mais important séjour d’étude au sein du groupe milanais Alchymia dont l’influence se marque notamment sur des cartons et des affiches, Jean-Pierre Scouflaire se livre à une abstraction où tout est simplicité, rectitude formelle et spirituelle. Son minimalisme est ainsi affaire d’esprit autant que de lignes ou d’espaces. À son propos, Michel De Reymaeker affirme avec justesse : « S’il compose, s’oppose ou propose, le silence est sensé : sa direction et son amplitude déterminent alors une plage de réflexion, un temps de pause, un espace de méditation. Avec rigueur, Jean-Pierre Scouflaire cherche à préciser cet espace, à noter les limites et à les décliner selon des nécessités internes et absolues, esthétiques autant qu’éthiques, plastiques certes, mais spéculatives aussi. »
Plus emportées dans leur discours, plus gestuelles dans leurs signes et leurs griffes, Sylvie Canonne et Anne Leloup, au-delà de techniques très différentes, au-delà de propos éloignés par leurs buts comme par leurs méthodes, s’apparentent néanmoins, en leur style aux confins de l’abstraction, par un souci de la ligne courante, du hasard simulé, du paradoxe maîtrisé. Chez S. Canonne, c’est cependant la balafre et le graffiti qui l’emportent, même si des plages d’aquatinte viennent parfois calmer les blessures de la plaque. Chez A. Leloup, c’est au contraire un parcours velouté de noirs profonds et de lignes erratiques qui domine, tandis que, subtile diversion, un élément à peine figuré, tantôt fleur, tantôt pétale, vient quelque peu troubler les réseaux générateurs d’abstraction. Par ailleurs, chez S. Canonne, un souci d’« écrire » émaille ses griffes et empreintes. Parfois titre, parfois griffe lui-même, le texte s’immisce dans la matière, dont il devient élément indissociable, parcelle de sens et de risque. Et l’imparfait voulu des formes plastiques convient admirablement à celui de la syntaxe littéraire : « Nous regardions à l’ombre l’eau qui devenait rousse à cause de la pierre. »
Lukasz Kurzatkowski « s’est, dit-on, adonné à la gravure pour résoudre certains problèmes qu’il rencontrait en peinture ». Il demeure, on l’a vu, un geste de peintre en ses linos. Ceux-ci, affirme Bernadette D’Haeye, « ne produisent pas des images qui visent à communiquer un message unique et efficace. Equivoques, ses gravures suggèrent au contraire de nombreuses interprétations ». Il est vrai qu’à travers les noirs puissants et somptueux gravés par Lukasz Kurzatkowski, on perçoit d’abord agencements de demi-cercles, de triangles, de ronds. Et donc ainsi, est proposée – présupposée – une vision abstraite du monde. Mais, au-delà, et par jeu d’association de regard et d’esprit, on découvre dans ces formes mûries tantôt visages, tantôt seins, tantôt pupilles, tantôt dents, ou mâchoires, ou herses… Monstres et machines s’enflent ainsi dans le regard du spectateur, soumis à l’« équivoque » langagière de Lukasz Kurzatkowski.
Telle équivoque surgit aussi des « objets » inventoriés par Claude Celli. Car c’est bien d’inventaires qu’il s’agit. Muni d’une lettre-repère à l’instar de ce qui se pratique dans les planches descriptives des encyclopédies, chaque « objet » lithographié évoque une machine, un meuble, une sculpture, un appareillage… Parfois seules, parfois « activées » par une main extraite d’un ancien manuel du XIXe siècle, ces « choses vues » sont grouillantes, expansives, fumeuses, déliquescentes. Une touche de surréel, une pointe de surréalisme teintent ce monde aujourd’hui empreint d’archéologie nostalgique et de scientisme détourné.
De raies fragiles, finement évanescentes sous le geste vibrant de la pointe sèche, surgissent, dans l’œuvre de Chris Delville, des personnages issus de métaphores paradoxalement intimes et cosmogoniques. Ces icônes confidentielles et lyriques s’accompagnent (comme chez Sylvie Canonne d’ailleurs) de notations textuelles poétiques et de titres tendrement ironiques : « Une Folle dans la ville ; Le Canard laqué aussi » ; « Sage thibétain devant ses tipis » ou encore « The One who has got a Monkey in Mind is a lucky One ». On ne peut ainsi oublier que Chris Delville aime dessiner mais aussi écrire, mêlant image plastique et construction littéraire. Ainsi l’affirme son texte « Le Jardin des Saules » : « Dans la lumière, les oiseaux sont comme des phares ; c’est eux les dessins. »
Chez Chris Delville, l’ironie merveilleuse – adjectif dont le sens est à saisir en tant que dérivé immédiat du substantif – est bien éloignée du sourire caustique et faussement naïf qui s’épanouit dans les combinaisons graphiques de Kikie Crèvecoeur. Chez cette artiste fascinée par la répétition sérielle d’images, voire de fragments d’images, le monde, même dur et agressif du kickboxing (un de ses sujets de prédilection), prend des allures d’imagerie transcendée par la schématisation des raccourcis et les choix surprenants des angles de vue. Le fourmillement quasi cinématographique de ces scènes singulières est par ailleurs souvent exalté par la combinaison de l’impression en noir et de la mise en couleurs à l’écoline. Tour à tour stridentes ou silencieuses, ces couleurs multiplient l’effet apparemment chaotique d’une représentation en réalité étudiée dans ses recherches d’équilibre et de nuances. Parfois, les « gommes estampées » de Kikie Crèvecoeur prennent des allures d’œuvres abstraites, presque minimalistes, comme dans la gravure « Nez, nez », où l’appendice, cent fois répété, se décline selon les innombrables variations « noir et blanc » d’une courbe ondulant au sein d’un triangle blanc. « Sérialité à travers un glissement progressif partant de l’imagerie pure vers une plastique devenant abstraite », souligne Catherine de Braekeleer.
Exubérant, frondeur, provocant, querelleur, mais profondément sensible et tendre, Thierry Lenoir, dans des bois virevoltants et gouailleurs, traque la difficulté d’être dans les repères les plus tragiques ou les zones les plus dérisoires : rues à malfrats, quartiers de bordels, bars interlopes, lieux de détention (comme dans son Hommage à Piranèse)… Chienne de vie: ainsi claque le titre que l’artiste donne à un de ses «albums». Ce dernier mot vient immédiatement à l’esprit, tant l’effet BD, cartoon ou image d’Epinal est latent dans ses planches. Et pourtant, c’est tout autre chose qui éclate en pleine figure du spectateur : car Thierry Lenoir fait mouche avec son jeu superbement asséné de noirs et de blancs ou ses compositions corrosives de lignes et de masses enchevêtrées (comme dans ces immenses linos de la série matraquante Nous sommes des clowns). C’est avec raison que Gabriel Belgeonne confie : « L’œuvre est dure, elle prétend avoir valeur de témoignage même si ce témoignage porte plus sur le climat d’un événement que sur les circonstances exactes. Les scènes sont composées de telle manière que tout concourt à l’effet voulu. Une valeur particulièrement descriptive ou symbolique est attachée à chaque détail toujours bien choisi de l’image. »
Lionel Lesire, en revanche, introduit au sein d’un univers moins exubérant, mais qui n’en est pas moins pertinent ni moins tragique. Chez ce peintre qui a voulu renoncer à la peinture pour entrer dans le monde quasi claustral des techniques de gravure les plus austères – mais sans doute aussi les plus poignantes –, l’homme, en tant que sujet, se retrouve nu face au corps et à l’esprit. Dédoublé par le mensonge (comme dans l’estampe « Un de vous deux ne dit pas la vérité »), confronté aux ligatures et aux liens, perverti – ou exalté – par le tatouage, l’individu, chez Lesire, se cherche une nature que l’outil du graveur suggère d’une multiplicité de petits traits acérés, perfides ou tendres. Car une tendresse intime infiltre les personnages gravés de Lesire, tendresse que l’artiste réserve aussi aux autres créatures du monde, plantes ou oiseaux (le coq, notamment, « taureau du pauvre » qui combat jusqu’à la mort).
Ainsi donc, les neufs lauréats des années 1989 à 1998 du Prix de la gravure ont démontré – à ceux qui en douteraient encore – combien l’estampe ou l’image imprimée est non seulement un médium immensément riche par son potentiel quasi infini de techniques (de «cuisines», aiment à dire « culinairement » les gens du métier), mais aussi un art sans cesse innovant, industrieux par son rapport à la matière, précis dans sa suggestion de l’image et de la métaphore, pluriel par son champ d’investigation des styles et des concepts. En ce sens, la gravure est peut-être, avec la vidéo, un des arts les plus contemporains qui soit. Et cela, au sein d’une des époques les plus « éveillées » que l’on ait connues, si l’on en croit cette phrase de Paul Valéry : « Une époque, peut-être, se sent « moderne » quand elle trouve en soi, également admises, coexistantes et agissantes, dans les mêmes individus quantité de doctrines, de tendances, de « vérités » fort différentes, sinon tout à fait contradictoires. Ces époques paraissent donc plus compréhensives, ou plus « éveillées » que celles où ne domine guère qu’un seul idéal, une seule foi, un seul style ».
– Pierre-Jean Foulon, Conservateur au Musée royal de Mariemont